« L'impression de croupir... » : avec ces jeunes qui s'ennuient ferme au travail
Feb 08, 2024
8 mins

Tâches monotones, objectifs barbants, perspectives d’évolutions proches du néant… Face aux déceptions pro, un nombre affolant de jeunes perdent le goût du travail. Un blues invisible et parfois tabou, qui pousse les plus cafardeux au quiet quitting - tout en précipitant d’autres entre les filets du bore-out.
Le travail, c’est la santé - mais encore faut-il que les missions impliquées attisent l’engouement ou la promesse d’épanouissement escomptée, aura tôt fait d’arborer les traits d’une corvée à peu près aussi engageante qu’un dimanche normand pluvieux. Une réalité morose, vécue - et subie - par l’écrasante majorité des jeunes générations. Au total, 74 % des Français confient qu’ils s’ennuient au travail, selon les chiffres rapportés par Air of Melty, à partir d’une enquête diffusée par l’agence d’intérim Qapa en 2022.
Derrière la statistique, l’ombre du spleen plane ; toujours selon la même étude, 61 % des interrogés déclarent « ne pas bien vivre du tout ce manque d’intérêt au travail », là où seulement 8 % affirment le « vivre très bien ». Mais comment a-t-on pu en arriver là, au juste ? Pour recomposer, pièce après pièce, la mosaïque des « motifs » de cette grande lassitude, quatre jeunes salariés ont accepté de nous partager le récit de leur apathie pro. Entre sensation cuisante d’avoir été berné par l’employeur, frustration créative et ambitions avortées. Témoignages.
« Je suis fatiguée de nager au milieu d’idées poussiéreuses » Giselle, 26 ans, graphiste
Cantonner un profil d’illustratrice à de la mise en page, c’est comme demander à un pâtissier de ne faire que des gâteaux au yaourt. Forcément, ça crée de la frustration. J’ai passé mes quatre années d’études post Bac dans une école de mode, où l’essentiel était de cultiver l’esprit créatif, les touches personnelles, la prise de risque. Alors, j’ai développé un style propre. Très orienté rétro-kitsch, avec des couleurs pétantes, une iconographie Y2K… Autant d’éléments que je n’ai jamais pu amener, de près ou de loin, à l’entreprise d’évènementiel dans laquelle j’ai été embauchée comme graphiste. Tout simplement parce que mon emploi consiste, pour 90 % du temps, à éditer des PowerPoint ultra-rasoir. Histoire de les transformer en supports attrayants, au regard des collaborateurs. Mais sans jamais aller « trop loin » dans l’esthétisation, attention ! Il faut toujours respecter les codes - un peu poussiéreux, un peu boring - de la charte graphique de l’entreprise, et l’ADN de la marque.
À chaque tentative de pas de côté, on m’a remis dans les clous en m’invitant poliment à « gommer » ma patte personnelle. Résultat, j’exécute la plupart de mes tâches en mode pilote automatique avec, au fond de la gorge, un goût amer. Pourquoi avoir employé un profil comme le mien, si c’est pour exiger que je reste au degré 0,01 de la créativité ? À force d’exécuter encore et encore les mêmes opérations, j’ai le sentiment d’avoir régressé dans mes capacités techniques sur Photoshop ou Illustrator, et que mon imaginaire s’atrophie à petits feux, faute d’être stimulé par des challenges créa’. C’est une sensation pénible, d’autant plus irritante qu’elle se double de l’impression d’être négligée, jamais prise au sérieux dans une boîte où je suis l’une des plus jeunes, et où la plupart me voient comme « l’originale ». Celle dont personne ne comprend les logiciels qu’elle utilise, qui a des goûts « bizarroïdes » certes intéressants, mais jamais au point de me faire confiance, en me laissant une marge de manœuvre sur un projet.
Dans cette atmosphère vieillotte, où les idées neuves se heurtent à des portes closes, j’ai vite compris que je ne trouverai jamais ma place. Alors, j’élabore des stratégies pour pousser la direction à me mettre à la porte ; j’arrive toujours en retard, je débarque en semi-pyjama, et met les voiles à 18h tapantes. Parfois, j’imprime même au boulot des créations perso, comme des calendriers géants aux motifs Harry Potter. Des choses qui n’ont évidemment rien à voir avec mon travail, afin de montrer que j’ai la tête ailleurs. Et les mains libres. Mais tous ces signes - criards, pourtant - de démotivation, mon équipe les perçoivent comme les énièmes manifestations de ma fameuse « marginalité ». De sorte que je me sens dans l’impasse - au point de trouver un exutoire dans le fantasme d’une vie alternative. Un grand claquage de porte, où j’abandonnerais mon job sans regard en arrière pour monter une ferme, dans l’arrière pays français. Et au fond, peut-être qu’il ne me manque qu’une petite étincelle, pour transformer ce rêve bucolique en projet de vie.
« J’ai été arnaquée de A à Z sur ma fiche de poste » Chelsea, 31 ans, happiness manageuse
Tout avait pourtant démarré sous d’excellents auspices. Alors que j’étais dans une période de chômage, et dans la recherche pressante d’un nouveau job, je suis tombée sur une annonce en ligne. Le nom du job ? Hapiness manager. Étant une personne relationnelle et très attachée à la qualité de vie au travail, j’ai de suite flashé. Au point de m’imaginer en train de contacter des prestataires pour organiser des dégustations de rosé, des sessions massages… Tout un projet. Lors de la phase d’entretien, on m’a affirmé que j’aurai toute la marge de manœuvre pour chapeauter ce type d’événement - tout en mentionnant, un peu vaguement, une « petite » partie d’accueil prévue dans ma fiche de poste.
Une fois embauchée, je suis brutalement redescendue de mon nuage, en admettant l’évidence : cette « petite » responsabilité allait accaparer 95 % de mon temps de travail. Alors que je me rêvais en chargée d’événementiel, je me suis retrouvée à gérer les réservations de salle des collègues, la réception du courrier… Pour tromper l’ennui, je fais des mots fléchés, je lis des articles. Je papote avec les employés de branches passionnantes - et ces discussions représentent la seule stimulation intellectuelle de mon travail.
À mesure que les mois passaient, j’ai développé une fatigue chronique, qui est l’un des symptômes du bore out. Et les choses ont pris une tournure encore plus inquiétante lorsque, à la perspective de ma trentième bougie, je suis passée par un épisode dépressif. C’était l’heure du bilan - et du verdict : je tournais en rond. J’avais un besoin quasi vital de trouver un autre travail, de prendre un virage dans ma vie. Mais mes recherches restaient infructueuses. Le coup de grâce est arrivé à un retour de voyage en Jamaïque, durant lequel j’avais découvert un autre rapport au travail, plus zen, plus épanoui. Comment ne pas être morose, en revenant dans le speed parisien, à un poste pour lequel je n’ai aucun intérêt, ne développe aucune compétence, et ne représente aucune plus-value - tout ça pour un salaire à peine supérieur au SMIC, en plus ! J’avais été bernée, de A à Z. Et pas question de garder ça pour moi. J’ai été transparente sur le sujet auprès de collègues - dont beaucoup étaient partis depuis mon arrivée, après avoir réalisé qu’ils avaient été, dupé comme moi -, et de mes managers. Tous ont affirmé « entendre » mes plaintes, mais sans m’offrir aucune perspective d’évolution. Alors je poursuis ma recherche d’emploi - sans fantasmer quoi que ce soit, cette fois. J’aspire simplement à un boulot sans trop de contraintes horaires, et avec une sécurité financière garantie, pour faire naître un projet indépendant que je mûris depuis des années. Et qui deviendra, je l’espère, ma source d’épanouissement.
« Ce travail, qui devait n’être qu’une planque temporaire, s’est transformé en piège » Pierre, 25 ans
Disons que rien ne s’est passé comme prévu. Après avoir décroché un diplôme en sciences politiques, je me suis fixé l’objectif « thèse ». Et en attendant de faire mûrir ce projet, j’ai pris un job dans une entreprise tournée vers la libéralisation du permis de conduire - le temps de l’été, seulement ! Et puis… le CDD s’est transformé en CDI. Accepter cette proposition de contrat était la solution de facilité avec, à la clé, la promesse du confort salarial, alors que je venais de mettre le pied sur le marché du travail. Et surtout : je me disais « c’est temporaire » - que nenni !
Pour diverses raisons, mon projet de thèse est tombé à l’eau et je me suis retrouvé avec, pour seul horizon professionnel, le rôle de « exam support hero ». Derrière cette formule aux accents de novlangue managériale, il y a 85 % de temps dédié à répondre par mail à des enseignants qui ne maîtrisent pas notre plateforme. « Bonjour Madame, merci de votre prise de contact. Nous attirons votre attention sur l’onglet… », etc. Des échanges redondants, à milles lieues de mes centres d’intérêt. Le monde de la tech’ et de l’automobile, pour être franc, je m’en fiche. Et puis, il y a le problème du décalage criant, entre mes valeurs et une ambiance d’entreprise qui banalise les remarques sexistes et racistes, tout en alimentant l’ubérisation de l’emploi. Comment s’investir dans une entreprise qui véhicule des idées autant à contre-courant des votres ? Ajoutez à ce casse-tête l’impression de perdre mon temps et de gaspiller mes capacités, et vous obtenez une situation asphyxiante.
Pour gérer, j’assume pleinement mon « quiet quitting ». J’écoute des podcasts au boulot, découvre de la musique et joue à la Playstation avec mon coloc’, les jours de télétravail. Bref, je fais le minimum syndical. Mais sans pousser le bouchon trop loin non plus, car j’ai conscience qu’en tant que personne racisée, j’aurai du mal à retrouver une telle stabilité d’emploi. Discrètement, je postule à des offres qui renoueraient avec les sciences sociales, dans une perspective qui ne serait pas juste orientée business, et dans une course aux bénéfices. J’aspire à des tâches qui me permettraient - enfin ! - d’avoir le sentiment d’accomplir quelque chose d’utile, à travers ma vie pro. Dans l’attente de ce nouvel élan, j’adopte une « résignation lucide ». Oui mon boulot m’ennuie, mais non, il ne me détruira pas. Pour maintenir la tête hors de l’eau, je mixe, je m’investis dans des projets musicaux, je monte un podcast. Ce sont ces activités annexes, et pas mon travail actuel, qui définissent ce que je suis. Et ce que je vaux.
« Pourquoi le travail serait-il autre chose qu’une corvée ? » Gaspard, 28 ans, informaticien
À en croire notre modèle d’happycratie, il faudrait absolument trouver son job fabuleux - « épanouissant », même ! Ce n’est pas mon cas, et je l’assume. Depuis plusieurs années j’exerce comme informaticien, et je n’ai pas peur de dire que mes tâches ne suscitent de l’intérêt. Ni à mes yeux, ni à ceux de la plupart de mes collègues - ni de la société, d’ailleurs. En soirée, on me demande rarement « mais en quoi ça consiste, exactement » ? Je le comprends cinq sur cinq. J’apporte les mêmes solutions aux même problèmes, tous les jours. Je suis remplaçable, et n’ai à peu près aucun impact social, comparé à un docteur par exemple - et après ? Après, rien. J’encaisse mon chèque à la fin du mois, puis m’éclate sur mon temps libre, grâce aux voyages et à la fête. C’est ainsi que j’ai toujours conçu l’équilibre de ma vie.
Tout travail a toujours été labeur à mes yeux, et essayer d’y voir un moyen de s’exprimer, voire de donner un sens à son existence… tout ça relève, a minima, d’une mystification. Mes revenus me permettent d’avoir la qualité de vie à laquelle j’aspire sans trop me fouler. C’est tout ce que j’attends d’un emploi, point à la ligne. Lorsque j’évoque cette philosophie en public, j’ai parfois l’impression de commettre un délit. « Mais tu n’aspires pas à mieux, niveau enthousiasme professionnel ? », non. « Et tu es heureux comme ça, au fond ? » Carrément ! À mon sens, l’immense majorité des travailleurs s’ennuient dans leur job. Mais ce serait trop douloureux, trop déprimant, de l’avouer. Alors on préfère se dire que oui, ça « a du sens », qu’il existe des fameux « métier de passion ». Ce sont ces mêmes personnes, souvent précarisés - journalistes indépendant, artistes etc - qui finiront par craquer. Salaire de misère, horaires changeants, horizon du secteur ombragé… Sacrée jambe, les « métiers de passion » ! Merci, mais non merci. Je préfère rester fidèle à ma pensée. Dans une société capitaliste, tout le monde doit bosser, c’est entendu - et même jusqu’à nos morts, puisque nos retraites s’envolent ! Foutu pour foutu, autant s’orienter vers l’emploi le plus safe. Celui qui vous donnera le maximum de moyens - temps libre, argent, prestige… - pour un minimum d’effort. Une équation de bon sens ; la seule qui vous permettra de refuser que votre vie toute entière orbite autour de la fameuse « valeur travail ».
Article édité par Manuel Avenel, photographie par Thibaut Braghini

More inspiration: Student trends

Aides financières pour les jeunes : ces coups de pouce méconnus qui peuvent aider
Car la tirelire cochon n'est souvent pas suffisante pour gérer les frais de transition des études au premier emploi.
Jun 15, 2023

Droit de grève : peut-on l'exercer en stage ou en alternance ?
Vous souhaitez vous joindre à un mouvement social et exercer votre droit de grève mais êtes en stage ou en alternance ? Quels sont vos droits ?
Apr 13, 2023

Paris : passage obligé, rêve ou repoussoir pour les jeunes diplômés
Entre les grandes écoles et universités, les nombreux stages à pourvoir, « monter à la capitale » est-il incontournable ?
Mar 31, 2023

ENQUÊTE : Derrière le boom de l’alternance, les abus des entreprises ?
Un boom de l'apprentissage en apparence, des pratiques douteuses derrière le rideau...
Jun 02, 2022

Réalité du monde du travail vs discours d'école de commerce : le grand décalage
Les écoles de commerces font-elles de fausses promesses à leurs étudiants ? Et pourquoi ? Décryptage de Maurice Midena.
May 24, 2022
The newsletter that does the job
Want to keep up with the latest articles? Twice a week you can receive stories, jobs, and tips in your inbox.
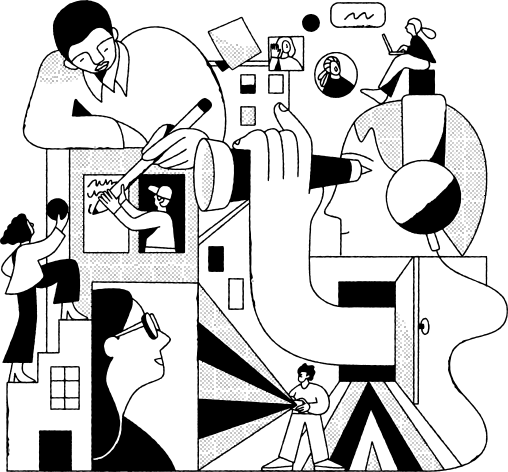
Looking for your next job opportunity?
Over 200,000 people have found a job with Welcome to the Jungle.
Explore jobs

