Portrait d'Ali Rakib | Job : protecteur de patrimoine
03 mai 2018
6min

À 35 ans, le fondateur de la société ForWeavers (“pour les tisserands”) n’a rien d’un dirigeant comme les autres. Ancien conseiller en insertion en banlieue, reconverti en aventurier solitaire, Ali Rakib parcourt les cinq continents pour dénicher des textiles ancestraux, vendus aux plus grandes maisons de luxe. Nous l’avons rencontré au début de l’année dans le cadre de notre magazine trimestriel afin de vous livrer le témoignage de son parcours inspirant.
 © Laurence Revol pour WTTJ
© Laurence Revol pour WTTJ
Ali, ton job en fait c’est quoi ? Chasseur de textiles rares ?
Pour ForWeavers oui, on peut dire ça ! Mais c’est le bout visible de la chaîne. Avant d’aller chercher le tissu, je vais d’abord chercher l’humain, identifier ses besoins et tous les risques sociaux liés à la disparition culturelle. D’où le nom de mon entreprise, qui signifie “pour les tisserands”. Mon objectif est de donner des solutions à des communautés et ainsi les rendre autonomes. En fait, le textile n’est qu’un prétexte. Je l’ai choisi car c’est le métier le plus universel au monde. Surtout, c’est un métier qui n’est pas tabou pour les femmes, et pour sauvegarder les patrimoines immatériels de l’humanité c’est à tous qu’il faut donner du travail.
Mon objectif est de donner des solutions à des communautés et ainsi les rendre autonomes. En fait, le textile n’est qu’un prétexte.
En fait, si on me demande quel est mon métier, je demande d’abord à la personne qui elle est. Si j’ai affaire au Président d’une institution, je lui dis que je suis conseiller en entreprenariat culturel. Si c’est un passionné d’archéologie expérimental, je lui dis que je fais de la reconstitution historique. Si c’est mon neveu, que je suis un aventurier. Je ne veux pas être réduit à une case.
Dans une première vie tu as été recruteur pro dans le foot, puis éducateur spécialisé… Tu n’as donc jamais rêvé à un diplôme ou à un métier en particulier ?
Toute mon enfance, je n’ai voulu qu’une seule chose : devenir vétérinaire dans la savane. Et puis, j’ai compris que ça me demanderait beaucoup d’études et j’y ai immédiatement renoncé. Je n’ai jamais aimé l’école. Je me suis toujours contenté du strict minimum. Mes parents n’ont eux-mêmes jamais été à l’école. Par contre, à la maison, il fallait filer droit, avoir la chemise bien boutonnée, parler poliment à la voisine… J’ai validé in extremis un Bac commercial puis je suis allé à la Sorbonne étudier les langues et civilisations orientales. Mais le système tableau noir - amphi, plus les trajets d’une heure et demi d’Elancourt à Paris… Je n’ai pas tenu. J’ai eu des opportunités dans le football et j’ai saisi l’occasion.
Quand on regarde ton parcours, on se demande toujours si tu as fait des choix ou si tu as suivi le destin sans trop y réfléchir…
Dans mon parcours, en fait, tout est absolument lié. Alors que j’étais entraîneur de football à Versailles, j’ai voulu m’engager dans ma ville et j’ai proposé à la mairie d’Elancourt de m’occuper des jeunes de la ville avec un programme autour du foot. Ils m’ont donc créé un poste : celui de Conseiller en insertion social et professionnel. Comme le textile, le football était un prétexte. Avec le sport, tu mets des gens dans un cadre, avec des horaires, du respect, des règles du jeu et un objectif commun qui nécessite de travailler et de se projeter dans l’avenir… Rien que ça, ça sort des gens de la précarité parce que ça leur donne un modèle à dupliquer dans le monde professionnel.
Avec le sport, tu mets des gens dans un cadre, qui nécessite de travailler et de se projeter dans l’avenir. Rien que ça, ça sort des gens de la précarité, ça leur donne un modèle à dupliquer dans le monde professionnel.
Tu te disais que c’était un passage de ta vie ou que tu avais trouvé ta voie ?
Je me disais : je rêve de cette mairie depuis que je suis tout petit ! Tout ce marbre et ce clinquant, au milieu d’un quartier compliqué… Pour moi et mes parents c’était un symbole de réussite. Sans compter que mon job était très gratifiant : j’aidais des gens à s’en sortir dans la vie. Au bout de trois ans, le rêve de la mairie s’est étiolé. J’avais l’impression d’être juste un artifice de communication, je ne me sentais pas soutenu… J’ai démissionné en 2006 et j’ai trouvé un poste d’enseignant dans un lycée hôtelier, pour accompagner des jeunes adultes trisomiques et handicapés. Et à nouveau je me suis dit : ça y est, j’ai mon métier pour toute la vie ! Sauf que là encore, je me suis confronté à la hiérarchie, j’avais l’impression de me battre quasi-seul pour cette classe… Au bout de trois ans, un médecin m’a arrêté parce que j’étais à la limite du burn-out. J’ai tout quitté et je suis parti à l’autre bout du monde.
 © Laurence Revol pour WTTJ
© Laurence Revol pour WTTJ
C’est comme ça que l’aventure ForWeavers a commencé ?
Oui. C’était au Népal et j’avais 26 ans. J’ai grimpé l’Annapurna tout seul jusqu’au dernier camp de base, sans guide ni porteur. Et plus je montais en altitude, moins il y avait de touristes et plus les gens étaient autonomes. Je voyais quatre générations de femmes tisser, vivre et rire ensemble, se transmettant un savoir de génération en génération. Au-delà de ce textile, c’est la langue qui était ainsi conservée dans ce village, les danses, l’usage ancestrale des vêtements qu’elles tissaient… Ça a été un déclic : on pouvait sauver un village et sa culture en assurant cette création. Je suis donc parti à la recherche d’autres textiles de par le monde et j’ai mis 100% de mon énergie et de mon temps à la création de ce qui est devenu ForWeavers.
Je voyais quatre générations de femmes tisser, se transmettant un savoir de génération en génération, ça a été un déclic : on pouvait sauver un village et sa culture en assurant leur création.
Comment es-tu passé de ce rêve incroyable à une entreprise ?
Le chemin a été long ! J’ai d’abord monté une association, je n’ai créé l’entreprise qu’en mars 2017 et j’ai pu lever 120 000 euros pour me lancer. Avant cela, il a fallu que je me forme à l’ethnologie en autodidacte, j’ai passé des heures à lire et à rencontrer des professionnels, et en parallèle je suis rentré en 2013 dans une couveuse d’entreprises. J’y ai tout appris du business : je n’y connaissais absolument rien ! Je vivais du RSA, comme aujourd’hui. Quand tu vis de ta passion, tu arrives à vivre avec 450 balles par mois. Comme on dit, “je ne gagne pas bien ma vie”, mais c’est toujours mieux que de perdre sa vie à la gagner. Là, je gagne ma vie, mais différemment.
Tes produits sont rares et chers, qui ont été tes premiers clients et sont-ils les mêmes aujourd’hui ?
Au tout début, je vendais mes tissus à des archéologues, intéressés par certains motifs, tracés ou broderies qui correspondaient aux standards français du 12ème ou 13ème siècle. Mais cette niche de l’archéologie expérimentale était trop petite. Désormais mes clients principaux sont des marques de haute couture (Chanel, Hermès, LVMH, Kering…) et des décorateurs d’intérieur.
Comme on dit, “je ne gagne pas bien ma vie”, mais c’est toujours mieux que de perdre sa vie à la gagner.
À quoi ressemble ton entreprise ForWeavers aujourd’hui ?
Je travaille seul, mais avec un écosystème très solide de vingt personnes autour du projet. Je ne fournis à mes acheteurs que des tissus écrus, c’est-à-dire sans couleur, car c’est avant tout la matière que l’on met en avant chez ForWeavers. Ce sont des biens très rares : tissu de lotus, tissu de bananier, laine de chameau… J’ai sourcé des produits dans 24 pays, mais pour le moment je ne propose à la vente que neuf pays différents et tout est vendu dans de très petits volumes.
 © Laurence Revol pour WTTJ
© Laurence Revol pour WTTJ
Est-ce que tu as un tissu préféré ?
Oui ! Et il n’est ni le plus doux, ni le plus cher, ni même le plus à la mode ! C’est celui du tronc de bananier, que je vais chercher au Cambodge. Ce que j’aime dans ce tissu, c’est qu’il provient d’un déchet organique. Le bananier est une herbe qui pousse en quatre semaines, et quand on coupe le tronc pour le relancer, il pourrit et attire des mouches et moustiques qui apportent des maladies. Récupérer les fibres dans les troncs est donc très positif d’un point de vue à la fois écologique et sanitaire. En plus, c’est un tissu très transparent, quasi plastique, que tu peux sculpter à ta guise. Il est d’ailleurs utilisé par la chapelière des reines de Belgique, du Luxembourg et de Suède !
Tu développes également une activité de conseil et tu donnes de nombreuses conférences… pourquoi ?
Au fil des années, je me suis rendu compte que mes connaissances étaient recherchées. Les entreprises me demandent des conseils sur des tissus, sur l’utilisation d’un motif ancestral particulier (il y a beaucoup d’impairs à éviter !), sur du patrimoine ou même sur des solutions RSE (responsabilité sociale des entreprises ndlr.) car je suis très engagé sur ces questions-là. Quant aux conférences, je crois que je continue à aimer l’idée d’enseigner…
Au fil des années, je me suis rendu compte que mes connaissances étaient recherchées… Quant aux conférences, je crois que je continue à aimer l’idée d’enseigner.
Tu as enfin trouvé le métier de ta vie ?
ForWeavers n’est pas un métier, c’est ma vie toute entière ! Mais je ne me vois rien faire de façon permanente jusqu’à la fin de mes jours. Peut-être que je vais tomber amoureux du poivre et me lancer dans une entreprise sur ce créneau ? Ou devenir casanier et me poser un peu ? Aujourd’hui, je n’ai pas de temps pour ma vie perso mais je garde toujours en tête que c’est un mal nécessaire et temporaire. À terme, je ne le conseillerai à personne. Dès que je me dégagerai un salaire, je m’arrêterai de travailler le week-end déjà…
Suivez Welcome to the Jungle sur Facebook pour recevoir chaque jour nos meilleurs articles dans votre timeline !
Photos : Laurence Revol pour WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : Parcours inspirants

De « Je suis Charlie » aux Jeux Olympiques : Joachim Roncin, créatif hors-norme
Découvrez le parcours inspirant du créateur du slogan « Je Suis Charlie », en pleine reconquête de son insouciance.
29 janv. 2024

Marie s'infiltre nous apprend... à mettre du culot dans notre vie pro
La comédienne, humoriste cultivant le goût des happenings et chanteuse Marie s'infiltre nous guide pour mettre une dose de culot dans notre vie pro.
04 oct. 2023

Apprendre des meilleurs : l'autodérision avec... David Castello-Lopes !
« Je n’ai jamais supporté les personnes qui passaient leur temps à expliquer à quel point elles étaient géniales ! »
05 juin 2023

Godard/Truffaut, Blur/Oasis, Manet/Degas : comment la rivalité impacte le travail ?
Comment avoir un rival dans son domaine professionnel peut se révéler être le meilleur comme le pire des moteurs pour sa carrière...
10 mai 2023

MISE AU POINT : Immersion en photos au sein de la cellule d'identification criminelle
Zoom sur ces experts de la police scientifique version française...
02 nov. 2022
La newsletter qui fait le taf
Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.
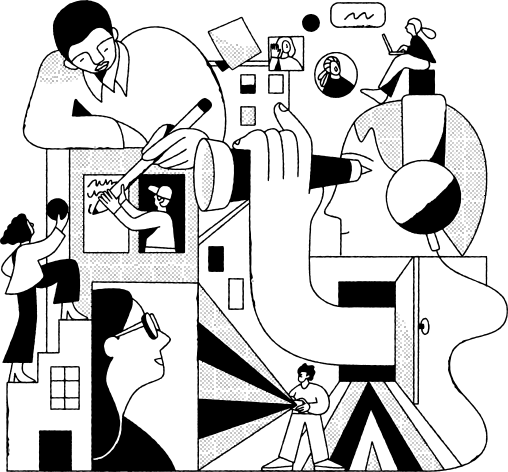
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?
Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.
Explorer les jobs